| |
Je suis
né le 25 avril 1928 à Berlin. Mes parents avaient le plus
grand magasin de coiffure de Berlin. Dans ma famille, ils étaient
tous musiciens. Mon tonton, le frère de ma mère, était premier violon
au philharmonique de Berlin. L’autre était deuxième flûtiste. Ma
grand-mère jouait de la contrebasse. C’était une grand-mère
allemande, elle était plus grande que la contrebasse. Ma mère était
au piano. Dans le temps, il n’y avait pas la télé, il y avait encore
des postes à galène, la petite aiguille sur la pierre, avec des
écouteurs. Après il y a eu les lampes. On écoutait la radio, ma
grand-mère faisait des gâteaux, on jouait de la musique avec toute
la famille (ils n’étaient pas encore tous morts à Auschwitz). Les
voisins étaient sur le palier et ils écoutaient ça, parce que [pour]
la musique, il fallait sortir et puis les gens n’avaient pas
d’argent. C’était une pauvreté qu’on ne connaît plus aujourd’hui.
Moi, j’ai ça dans l’âme, la musique.
Ma mère était française par un premier mariage. Quand je suis arrivé
en France, en 1933, je suis descendu dans la cour de l’école le
premier jour et j’ai dit « je ne peux pas parler avec les enfants !
» Ils parlaient français. En trois jours, je parlais comme tout le
monde. Je voulais être musicien, je ne voulais pas être autre chose.
J’aimais toutes les musiques. J’ai été élevé avec « Le Chanteur de
Jazz » : Al Jolson. Il se déguisait en noir. Ma tante me gardait.
Elle voulait courir les garçons ou aller danser, mais moi, je ne
voulais pas dormir. Pour que je dorme, elle me passait DaDaDaDaDa «
Sonny boy » de Al Jolson. Elle chantait sur le disque, je commençais
à m’endormir puis elle allait courir le guilledou : c’est comme ça
que je suis venu au jazz. J’ai été nourri avec les opérettes : le
Pays du Sourire, Franz Léhar, L’Auberge du Cheval Blanc. Le jazz, ça
m’avait titillé, ce « Chanteur de Jazz ».
J’ai fait l’armée dans l’armée israélienne, puis dans l’armée
Française. On n’avait pas les moyens, alors mon père ne m’envoyait
rien. Je savais déjà jouer un peu de guitare. J’ai fait mon service
au 4ème cuir [cuirassier], en 1951. J’étais dans les chars. Avec un
autre jeune qui jouait très bien, on allait faire danser les anciens
dans les chambrées. On faisait une petite quête. Il y avait beaucoup
de gars du nord qui ne savait ni lire ni écrire, à l’époque. C’est
moi qui écrivais les lettres. Eux ils recevaient des colis avec des
sauciflards, des gâteaux, alors ils m’en donnaient un peu. Je n’ai
jamais bu d’alcool de ma vie : c’est comme ça que j’ai gardé mon
teint de jeune fille. « Je te donne mon pinard, tu me donnes ton
pain ? » Alors je me bourrais de pain, avec de la flotte par-dessus,
ça bourrait bien. J’ai survécu comme ça.
J’ai commencé par la basse. La contrebasse. Je ne savais pas jouer
mais je faisais « DoumDoum » sur ce qui se jouait à l’époque. Il
fallait [faire] 5 kilomètres à pied. Je portais ma contrebasse sur
l’épaule pour y aller. Après le bal on me donnait dix francs, je me
rappelle. Il fallait que je rentre à la maison avec la contrebasse
sur le dos. Il y avait de grosses cordes en boyau.
J’ai fait tous les métiers du monde. Mon père voulait que je sois
tailleur. Ça ne me plaisait pas trop. Après j’ai fait fourreur. J’ai
travaillé en usine. J’ai travaillé le métal, j’ai travaillé le bois.
Mon père m’a foutu dehors en 52 quand je suis revenu du service. Il
voulait que je fasse un autre métier : n’importe quoi, sauf la
musique. Il faisait moins vingt-cinq, avec une guitare qui n’était
pas à moi. J’ai couché sous les ponts, sans pardessus. Je voulais
devenir musicien. J’ai travaillé mes do ré mi fa sol la si do pour
être le meilleur, et chaque fois, quelqu’un me disait « Oh oui ; toi
tu joues bien, mais l’autre, là, il joue mieux … » J’allais
l’écouter, et allez : au boulot jusqu’à ce que je le détrône. De fil
en aiguille, je suis rentré à la télévision, à Luxembourg. De 56 à
59. J’ai été trois ans à Télé Luxembourg.
Ma première guitare, elle avait était faite par M. Didier, à Metz. Il y a son fils, qui a repris, qui fait aussi
des guitares, maintenant. Il faisait des violons et des guitares.
Je voulais y arriver : mon père m’avait foutu dehors : « je vais
faire voir à mon père qui je suis ! ». J’ai tellement travaillé, à
force de dix, quinze heures de travail par jour, [que] j’ai fait des
progrès. Le chef d’orchestre de Télé Luxembourg a entendu parler de
moi et il m’a pris dans l’orchestre parce qu’il voulait quelqu’un
qui joue un peu de jazz. J’ai tellement plu que j’ai eu jusqu’à
vingt-cinq musiciens derrière moi. J’étais en soliste. Il n’était
pas question d’en mettre une à côté, parce qu’il n’y avait pas de
play-back, à l’époque. Je suis devenu célèbre, je roulais en voiture
de course. J’ai accompagné tout le monde, tous les artistes de
l’époque. Luis Mariano ; Brel, tout jeune, qui débutait ; Jacques
Martin, qui débutait (ça c’était à Paris, au Pavillon
d’Ermenonville, au bois de Boulogne). Il avait du talent, lui...
J’avais envie d’une Gibson à en mourir. J’allais en voir chez Percy,
à Bruxelles. C’était en 56, au début. Je ne pouvais pas me la payer
parce que je débutais à la téloche, je n’avais pas encore d’argent,
je n’avais pas encore de voiture de course. J’y suis allé un matin
et puis j’ai vu les Gibson, avec les amplis. Et puis il m’a vu … Et
il a dit « Mais entrez, monsieur ». Il faisait froid. « J’ai pas les
moyens d’acheter une guitare comme ça … » « Ça ne fait rien… ». J’ai
presque pas osé la toucher. J’aurais bien voulu[l’acheter], mais je
n’avais pas l’argent. Et à crédit ? C’était pas comme aujourd’hui …
Je suis venu à Paris pour la première fois en 53. En 53, même un
flic qui jouait du sifflet, il trouvait du boulot. Y’avait du
travail pour tout le monde. J’avais travaillé ma guitare jour et
nuit : c’était moi, comme Bireli [Lagrène] aujourd’hui, qui jouait
le plus vite. J’ai conquis la capitale en un jour. A Paris je jouais
dans les boites, au Big Ben, rue de Ponthieu. J’ai joué partout.
J’ai joué dans tout Paris : j’avais la notoriété. Ça a été tellement
vite. Tout le monde me voulait. J’ai travaillé au Fouquet’s Bar, au
rond-point des Champs-élysées. Je jouais électrique. C’était un
vietnamien qui m’avait fait une guitare, copiée sur une guitare
américaine. Une copie de Gibson avec deux micros. Mais ça n’allait
pas. C’était en 52, quand je travaillais chez les américains, à
Verdun.
Django, je ne l’ai pas connu, j’étais à Télé Luxembourg. J’ai connu
ses enfants. Babik, je l’ai connu [quand] il avait neuf ans. J’étais
très lié avec Lousson, son fils aîné, qu’il n’a pas reconnu, qui
s’appelait Baumgartner. J’ai une Selmer, c’est la femme de Django
qui me l’a donnée, parce que Lousson me devait du pognon. Il n’a pas
pu me le rendre. Elle me dit « tiens, alors : prends la guitare ».
Je m’étais fait faire une Favino. 9, rue de Clignancourt. Favino
était avec Chauvet, qui s’est suicidé. Il faisait des manches trop
larges et trop gros. J’ai dit : on ne peut pas jouer sur des manches
comme ça ! Ils sont trop larges. Ils faisaient des guitares qui
venaient de la guitare classique. Avec des manches larges comme
l’avenue des Champs-Élysées. Pour jouer en barrés. Pour le jazz et
la variété, ça n’allait pas. Je lui ai demandé de faire un manche
plus fin mais il n’y arrivait pas.
Chez Major, j’ai vu les amplis dans la vitrine. On a discuté. «
C’est un M. Steve Brammer [qui les fabrique] » Il était autrichien.
Moi, de Berlin. Il adorait tout ce qui était Amérique. Il avait la
[Chevrolet] Camaro. J’ai connu Steve comme ça. J’ai travaillé chez
lui. RV c’est Major. Ils s’étaient associés. Ardourel, c’était pas
le grand patron. Avec sa femme, c’était le gérant, Rue Dupéré.
J’habitais juste en face à l’hôtel. Il recevait à l’époque les
guitares de Suède. Levin. Et c’est moi qui montais l’électronique
qui arrivait à part, pour me faire un peu de pognon, la nuit, chez
Major Conn, derrière. Comme j’avais une voiture de course, il
fallait que je travaille beaucoup. Une Porsche. J’ai toujours eu des
Porsche toute ma vie.

Steve, c’est le premier qui m’a fait un ampli à douze haut-parleurs.
Parce que je voulais de la puissance. Je pouvais m’exprimer, on
m’entendait partout. Dans les bases américaines, ça y allait … Les
haut-parleurs, c’étaient des Celestion.
Q. Les amplis RV, il s’en vendait, beaucoup, ça partait
régulièrement ?
Oui, il fallait les commander. Steve et moi on les fabriquait, rue
Muller, à Montmartre. Il fallait scier des plaquettes, il n’y avait
pas de circuits imprimés. Il fallait souder. C’était la nuit. Moi
j’écoutais, je disais « Celui-là, il va revenir … » « Mais non !
Toutes les mesures sont bonnes … » et l’ampli revenait. Les
sonorités, c’était pas ça. Il savait qu’il pouvait compter sur moi
pour trouver ce qui n’allait pas. Major, on livrait partout, il n’y
avait que nous, à l’époque.
Des anecdotes, chez Major, j’en ai des tonnes. Un jour un type vient
avec une espèce de guitare avec un micro dessus. « Vous faites des
amplis ? » On faisait les amplis RV. C’était un sud américain, un
colombien ou quelque chose comme ça. Il branche sa guitare. « Vous
pouvez me jouer quelque chose ? » « Oui, qu’est-ce que vous voulez ?
» : « Stardust ! » J’ai pris la claque de ma vie. C’était un grand
artiste.
Une autre fois, y’a un type qui vient avec un fût, je ne savais pas
ce que c’était [un steel drum]. « Je voudrais un ampli pour ça ». «
C’est un instrument, ça, monsieur ? » « Oui … ». Je vais voir
Ardourel, on colle un micro en dessous, un micro DeArmond. [On le
branche sur] l’ampli de Steve. « Vous pouvez me jouer quelque chose
? » « Oui, qu’est-ce que vous voulez ? » J’étais méfiant : je dis :
« Stardust ! » « Oui, monsieur ! Il se met à taper là dessus avec
deux bouts de bois avec des rondelles en caoutchouc. Il m’a fait un
concerto ! Du coup, je lui dit : « monsieur, vous jouez où ? » « Au
Lido … »
Ardourel, il est mort d’une crise cardiaque.
Q. Vous pouvez décrire le son d’un micro RV ?
Il a essayé de copier les micros Gibson, puisqu’il n’y en avait pas.
Il essayait d’avoir le son américain. Tout dépendait du nombre de
spires. Il y avait un type qui nous les bobinait, à Montmartre. Rue
Nicolo, dans le haut de la rue de Clignancourt. Alors, il disait «
fais moi tant de tours … » et puis on essayait. Mais il n’y pas que
le micro. Il y avait l’ampli, il y avait la guitare. Y’a tout … Même
sur une planche, le son est différent.
Q. Vous, musicien, quels termes utilisiez-vous pour communiquer avec
Steve Brammer, électronicien ?
« J’ai pas le son ! » « Mais si, y’a le son : toutes les mesures
correspondent. Est-ce que c’est bon ? » « non ! »
Et puis il a entendu parler de Jacobacci. On a été les voir (Roger
et son père). Dédé il est venu après. Ça a fait le trio. Robert
[Jacobacci], il était dans l’hôtellerie.
[Roger,] j’avais connu son père qui fabriquait des banjos. Il était
à côté du cimetière du Père Lachaise, rue Duris, au fond de la cour.
Il savait faire les vernis [au pistolet]. Je lui ai demandé de faire
des manches petits, pour que je puisse faire les basses, les
harmonies. Il a copié le manche, un peu, sur la Levin. Mais ils ne
résistaient pas, ils venaient en avant. Quand les manches
travaillent, quand ils vont vers l’avant, ça devient difficile à
jouer. A l’époque on jouait avec des cordes, c’était des 14-56.
Alors il a fait des manches en métal, en alu. Ça faisait froid,
c’était pas ça. Après, il a fait des manches avec deux barres
d’acier dedans. Mais on ne pouvait pas les rectifier. Un manche,
quand il doit travailler, les deux barres, il s’en fout … Les
premiers manches qu’il a fait comme ça, c’était sur la Texas ou la
Stevens, et là, j’ai pu jouer ! La Texas, c’était pas tout à fait
ça. C’était un bon manche, déjà.
Q. Roger Jacobacci nous disait qu’il avait été très influencé par
Hagström pour l’épaisseur des manches. Il y a peut-être d’autres
influences que Levin ?
L’influence principale, c’était moi ! Le summum de Jaco, c’est la
Stevens. Tout le monde en avait. Roger David [aussi]. Elle était
bonne, cette guitare. Jusqu’à ce qu’il [Roger Jacobacci] achète une
Gibson. Il a démonté le manche pour copier le truss-rod de Gibson,
qui est réglable. Un manche, il n’a pas besoin d’être rigide. Il
faut qu’il soit réglable. Quand il va vers l’avant, on lui donne un
tour de clé, il retourne vers l’arrière … et lycée de Versailles.
Roger, c’est lui qui a fait les plus beaux manches. Il faut que le
manche soit complètement rectiligne. Il y a trois trucs sur une
guitare pour qu’un manche soit jouable : c’est la rectitude du
manche, la hauteur des cordes au dessus de la touche et il faut que
ce soit juste à la douzième case. C’est les trois paramètres. J’ai
mis tout ça au point avec Roger.
Q. Il y avait d’autres employés ?
Je ne sais pas, il est possible qu’ils se soient fait aider …
Q. Vincent, il s’en occupait, de tout ce qui était guitares
électriques ?
Seulement Roger … Roger, il nous a écoutés. Pas que nous savions
faire des guitares ; mais on avait des besoins, pour jouer. Lui, il
nous écoutait. Favino, il n’a jamais voulu écouter.
Q . Est-ce que Steve Brammer emmenait les guitares à Jacobbaci et
Jacobacci montait les micros ou est-ce qu’il [Jacobacci] emmenait
les guitares à Brammer et Brammer montait les micros ?
C’est nous ! C’est nous qui montions les micros. 11, rue Emile Level,
dans l’atelier. Maintenant, je ne sais pas si on ne lui filait pas
aussi des micros pour qu’il les monte …

Les guitares étaient toujours fausses, à l’époque. Les chevalets en
bois, il y en a qui sont découpés pour qu’à la douzième case ce soit
à peu près juste. Et moi j’ai inventé ce chevalet. Le chevalet
Gibson, il faut le tournevis pour le régler. Celui-là, non. Avec ce
chevalet là, moi je peux régler tout de suite. Les octaves sont
toujours justes. [On soulève légèrement la corde. On déplace le
pontet mobile à l’emplacement souhaité avec le pouce. De retour dans
sa postions initiale, la pression de la corde suffit à tenir le
pontet]
Il [Steve Brammer] les faisait faire par un type qui travaillait à
la SNCF, « à la perruque » [production en entreprise d'objets à
usage personnel, réalisés sur temps de travail] et j’allais les
faire chromer au « Passage de la Main d’Or ». Il n’y a que Brammer
qui les avait. Il ne les vendait qu’avec ses guitares. A l’époque on
ne déposait pas les brevets. On fabriquait, ça se vendait …
Q. Major, c’était le magasin important à l’époque ?
Il n’y avait personne d’autre.
Q. Beuscher, La maison du Jazz ?
Il n’y avait pas les amplis américains, Gibson et tout ça. Il n’y
avait que Brammer. Et puis Stimer, le petit machin Stimer : le
Fidelis. Des petits amplis avec deux portes, comme ça. Stimer
c’était une marque de micros. Django jouait sur Stimer. Fidelis,
c’est un ampli qui est fidèle.
La Texas
Q. Qui c’est qui l’a dessinée, la guitare ? C’est Steve ou c’est
Roger ?
Sincèrement, Roger, il savait pas. C’est mon ami, je ne dis pas ça
pour le démolir. C’est Steve, [qui a] peut être copié sur les
ricains … [Les Paul STD gold top] Avec trois micros, ça nous
permettait, avec les potars, d’avoir des sonorités différentes. Moi
je l’avais en dorée.
J’ai eu la Texas avec 3 micros.
Q. On pouvait démonter l’arrière …
Bien sûr ! Steve à dit : « On ne vas pas s’emmerder à aller dessous,
avec des trucs … Qu’est ce que c’est emmerdant pour aller dessous,
avec les fils. On va faire un fond, puisque de toute façon c’est une
planche électrique, on s’en fout de la sonorité. Et on a l’accès …
On faisait la soudure»




En 1959, Télé Luxembourg s’est tournée vers l’Allemagne. Il y avait
ce présentateur, Camillo, qui a chanté, là. Zag Warum. Je suis parti de la
télévision, il y avait encore les américains à Etain . J’ai fait
toutes les bases américaines en France. On s’appelait « Les
Continentals ». Je travaillais aussi avec des orchestres allemands,
des petits big bands. Notre impresario, c’était un hollandais. Ted.
Je ne me rappelle plus son nom. Je les faisais toutes. La Rochelle,
Royan, Châtelaillon. Ça suivait ; ils étaient partout, les
américains, en France. Il n’y avait pas de musiciens américains,
c’étaient les musiciens français et allemands.
En 1960, j’ai travaillé avec des accordéonistes. J’ai travaillé avec
Jacky Noguez. Il y avait un accordéoniste monstrueux. Jack Ellen,
il s’appelait. J’en parlais avec Marcel Azola, l’autre jour. Je lui
dis « Marcel, tu t’en rappelles, de Jack Ellen ? » « Ouille ouilleouille … » Quand il était en concours, ce n’était pas la peine
d’y aller, il se les payait tous. On jouait, Jack Ellen et moi, dans
ce bar, à Etain. On jouait du jazz, il jouait les valses musette à
l’accordéon. Je sortais de la télé, j’étais une vedette, je roulais
en voiture de course. Il y avait une fabrique de poupées, là, juste
en face. Les poupées « Petit Collin ». Il y avait 600 ouvrières :
j’ai fait un carnage, là …
Déjà les orchestres commençaient à se restreindre (je ne parle pas
des grandes formations). Moi, on me prenait parce que je faisais les
basses. Je faisais les harmonies, la mélodie. Je pouvais tout faire
en même temps. Je remplaçais un pianiste, je remplaçais un bassiste.
Personne ne pouvait écarter les doigts comme moi. Je fais des
accords que personne ne peut faire. J’arrivais à joindre six cases.
Je jouais avec le pouce aussi. Je fais les basses avec le pouce.
Vous savez comment ça s’appelle, cette façon de jouer, là ? C’est du
« voicing ».
J’ai fait ça parce que souvent j’étais tout seul. Je voulais
reproduire le son des orchestres. C’est pour ça que j’ai développé
cette technique.
L’Ohio de Johnny
L’Ohio, c’était la copie de la Fender. Johnny, je lui ai vendu sa
première guitare. Pour 25 anciens francs par mois. Il ne pouvait pas
plus. L’Ohio rouge.
Q. Après qu’il soit passé à la télé, ça a du se bousculer, dans le
magasin …
Évidemment ! On vendait, on vendait, on vendait. Le son, avec les
micros de Steve, n’était pas mauvais. Et ils ont gagné des millions
… L’Ohio, c’était ça mais … c’était pas ça. On ne pouvait pas luter
avec Fender.
Q. Dans les années soixante, quand vous avez vu arriver le rock&roll,
le yéyé, comment avez-vous réagi ? Vous avez été emmené à en jouer ?
Je savais que c’était la fin des temps. Il n’y a plus qu’un dieu sur
la terre, c’est le pognon, le dollar. Marcel [Bianchi], quand il
jouait le « Vol du Bourdon », il dépotait terrible. Quand j’ai vu
arriver les Shadows, je n’ai plus jamais eu besoin de laxatifs.
C’est pas de la musique. La musique c’est, si je vous joue par
exemple « Paris, je t’aime »...

... « Puisque vous êtes
debout, passez-moi ma « poêle » [Simon Lustigman a sa Gibson ES-175D
a porté de la main et illustre ses propos en jouant les morceaux. S.L.
joue la mélodie note à note puis en accords]. Avec l’orchestration …
Là, il y a de l’harmonie, il y des basses. Y’a tout. Aujourd’hui,
ils font ça [bend]. Quand y ‘a trois accords … Et encore. Charles
Trenet avait une chanson à laquelle personne n’a fait attention. La
Java du Diable. Vous avez écouté les paroles ? C’est le diable qui
vient sur la Terre… Le rock&roll, c’est la Java du Diable.

La Stevens
A la télé, je jouais sur Stevens. On apprenait petit à petit, vous
savez. [Sur la Stevens,] avec les quatre vis, ça permettait de
monter ou de descendre les micros. Il y avait déjà des inverseurs de
polarité. Cette astuce là, c’est Steve qui l’avait pondue : il avait
fait de l’électronique. Moi, j’avais trois micros. On branchait le
premier micro, puis le deuxième, puis le troisième. Ça nous donnait
sept possibilités de sonorités différentes. Plus les inverseurs de
polarité. Sur les amplis, ce n’était pas comme aujourd’hui, il n’y
avait pas les équaliseurs paramétriques. Il y avait grave, aigu et
puis c’était tout.
J’ai fait mettre trois micros pour avoir les différentes sonorités.
Celui-là [le micro manche], c’est la plus belle sonorité qu’il y a
sur une guitare. En bas, c’est la plus vilaine ; aigrelette, près du
chevalet. Et entre les deux … mon cœur balance. Alors on pouvait, en
dosant, avec les boutons, avoir les sonorités qu’on voulait. On
arrivait dans des salles, ça sonnait terrible avec l’ampli, il y
avait une très bonne acoustique et on arrivait dans des salles où ça
ne sonnait pas du tout. Alors vous pouviez rectifier grâce aux trois
micros et aux potentiomètres à glissières.
Les disques des Stevens

[Le nom du groupe], les Stevens ça vient de lui [Steve Brammer]. On
s’est appelé comme ça pour le remercier de nous avoir fait des
amplis et tout ça …
C’est moi qui ai fait les arrangements.
Honky-Tonk … tonc tonc tonctonc.
Premier Rendez-vous : ça c’est pour ma mère, qui est morte le
dernier jour de la guerre à Lyon.
Guitar Boogie que j’ai copié, à peu près, sur celui de Les Paul.
Et Peter Gun de Henry Mancini.

Il y en a eu deux. L’autre est rouge vif, je l’ai fait [les
arrangements] pour le copain de Michel Legrand, Francis Lemarque.
J’avais enregistré ça à la comédie des Champs-Élysées, avenue
Montaigne.
Haut-parleurs à excitation

Steve m’avait fait un ampli comme ça avec deux haut-parleurs spéciaux.
Des hauts parleurs à excitation. Un haut-parleur, il a un aimant,
derrière. Ceux-là n’en avaient pas. Ils avaient un bout de ferraille
(ça pesait une tonne, mais j’étais jeune et beau …). Un système
électronique qui remplaçait l’aimant. Ça c’était mon ampli avec les
deux haut-parleurs à excitation. J’en ai rendu fous, des orchestres,
avec ça … C’était d’une puissance !
Q. A l’époque des Stevens, en 63, vous travailliez toujours avec
Steve Brammer ?
Bien sûr ! Quand je travaillais pour lui, rue Etienne Muller, ça
arrondissait mes fins de mois. Après, il a déménagé rue Emile-Level,
porte de Clichy. Là on a re-travaillé ensemble.
Q. Les amplis Alpha ?
Il a voulu s’agrandir. Y’avait les sonos. Les amplis guitares ça
marchait moins bien parce qu’on a commencé à importer des Fender et
des Gibson. Ceux qui pouvaient se les payer … C’était surtout les
guitaristes de studios qui se les payaient. Ils n’allaient pas
s’acheter des Jacobacci.
Il [Brammer] avait « fait son trou » avec Star Musique.

Là je joue avec la Jacobacci, vous voyez, la Stevens, c’était une
publicité pour Schneider.
Gimenes, je l’ai connu, il faisait son service militaire à Verdun.
Il avait une perm’. « Je joue de la guitare … Je suis à la caserne,
à Verdun» « Je viens te chercher, on ira faire le bœuf … ». C’est
comme ça que j’ai connu Raymond.
Benedetti, je n’ai pas travaillé avec lui. Je suis fidèle en amitié.
J’avais commencé avec Brammer, depuis tant d’années. On a travaillé
tant d’années ensemble. Je ne pouvais pas lui faire un enfant dans
le dos en ventant du matériel autre que le sien. Michel [Benedetti]
l’a compris. On s’aimait bien, avec Michel.
Q. Vous l’avez rencontré comment ?
Il travaillait
chez Concone, à Marseille. Il prêtait des amplis Ampeg ou Standel,
pour les lancer. A l’Olympia, les groupes qui passaient venaient
avec des amplis bidon. Et lui, il emmenait des amplis terribles.
Les amplis Selmer, Michel, il les avait fait passer par les amplis
de l’Olympia. Il y avait des haut-parleurs énormes. C’était le son des Shadows. Le lendemain,
tous les petits idiots, là, ils ont dévalisé Paul Beuscher. Ils
avaient un ampli de merde, alors que ceux de Steve étaient
meilleurs. Tout le monde a plongé. Michel, il a bouffé le marché
comme ça. Il a travaillé avec Leprêtre. Les amplis Standel avaient
quelque chose de particulier. Quand ils tombaient en panne, il y
avait des tiroirs. Vous enleviez le composant électronique et vous
le remplaciez. C’est ce qui a fait, un moment, le succès de Standel.
Michel, il s’est adapté à la période « électrique » ; Brammer, il
été resté à la variété et au jazz. Mais il [M. Benedetti] voulait se
faire un nom avec ses micros de guitare.
Q. Paul Beuscher, c’était le concurrent de Major ?
Non. Paul Beuscher, c’était un magasin de musique, mais il vendait
des saxos, de tout. Des guitares quand il a vu que ça marchait et
que les Shadows sont arrivés. Il a eu les amplis Selmer. C’est là
qu’il a commencé à s’envoler.

Après la vague yéyé, on allait à Pigalle, chercher le
cacheton, le samedi et le dimanche. Je me suis laissé pousser les
cheveux longs, et tout ça. J’étais déjà trop vieux, je ne faisais
plus gamin. Alors, qu’est-ce que j’allais faire ? J’ai appris la
musique tzigane. La musique Tzigane, c’est du roumain, du russe, du
hongrois, du grec, de l’israélien, du polonais, du yougoslave … Il
faut un répertoire terrible. Il faut connaître, parce que, quand
vous faites les tables, c’est là qu’on vous donne le plus d’argent.
Y’a des vieux birbes qui viennent avec des petites nanas dans les
boîtes, dans les soirées … « En 1925, en Pologne, y’avait un petit
air, comme ça …vous connaissez ? » « Oui monsieur ! » On le joue, il
tombe sur le cul. Alors là, il sortait un billet de 500 balles !
J’ai fait ça pendant 30 ans. Ça vous acquiert un savoir terrible.
C’est pas ma musique préférée …
Q. Les guitaristes allemands, vous les avez connus, Attila Zoller …
Je ne l’ai pas connu personnellement. Je crois qu’il était
autrichien. Billy Lorento [Bill Lawrence]. Attila, je crois qu’il
jouait du violon aussi. Elec Bacsik. J’ai fait des séances avec lui.
Lui aussi, il jouait de la contrebasse. Et alors, il adorait le vin
rouge, parce que les hongrois, ils se pintent au « gros rouge qui
tache ».
Q. C’était avec quels orchestres ?
Oh, vous savez … J’ai eu tellement de boulot, à cette époque là !
Tous les violonistes étaient hongrois. Avec Toscano … Fleury, un
violoniste roumain.
Quand vous connaissez 3000 morceaux dans les 12 tonalités, parfois,
vous êtes indispensables dans certaines affaires. Quand vous allez
au cirque, les petits jeunes : ils font trois sauts périlleux, ils
traversent un cerceau en flamme, les yeux bandés. Et puis il y a le
porteur qui les choppe, qui les renvoie. « Bravo ! » Le porteur,
lui, il n’a jamais de bravos. Et c’est lui qui est important,
pourtant. Sans lui, rien n’est possible. Moi, j’étais le porteur,
parce que je savais qu’un bon porteur, il gagne des sous. Vous êtes
indispensable. Alors, comme j’étais un accompagnateur hors pair,
j’ai travaillé.
Q. Vous avez eu des élèves ?
Oui, tous ceux que j’ai eus ont bien réussi. Y’avait de jeunes
américains… « My year is a day ». Comment ils s’appelaient, ceux là.
Les Irrésistibles. Tom, Tom Arena. Son père c’était [un ponte] dans
les pétroles, rue du Colysée. Texaco ? Et Tom, il a composé ça. Je
vais chez lui : des amplis jusqu’au plafond, des guitares partout.
Je lui dis « Comment tu as fait ? ». Son père avait du pognon … « Eh
ben, j’ai composé le morceau ! »
J’ai fait aussi représentant de commerce. J’ai épousé une femme, il lui fallait tellement de pognon
…Je travaillais vingt-cinq heures par jour parce que vingt-quatre ça
ne suffisait pas ! J’ai été représentant de commerce, de musique …
Je vendais de tout, des magnétophones, les Revox, les Dual, des pèse
personnes, Seb … Toutes les femmes m’ont
quitté… Sauf la mienne !
Je suis devenu un des meilleurs accordeurs de pianos du monde.
J’avais mille pianos qui tournaient toute l’année. C’était en 77. Ma
fille voulait devenir concertiste. Je lui ai acheté un piano et
quand il a été faux, il a fallu l’accorder. C’était cher. J’ai dis :
« moi je vais l’accorder, le piano ! » mais c’est impossible
d’accorder un piano si on n’a pas appris. Pour qu’un piano soit
juste, il faut l’accorder faux. A cause des dièses et des bémols qui
n’existent pas sur un piano. Il faut tricher. Un musicien ne peux
pas accorder un piano parce qu’il entend juste. J’ai eu une idée
formidable. J’ai été voir un grand savant, c’est lui qui a fait les fours à induction.
Gaboriaux. Je lui demande : « vous ne
pouvez pas [me] faire un appareil pour accorder les pianos ? » «
Facile ! On apprend ça en première année de physique acoustique… »
Il m’a fait un appareil qui faisait huit kilos : un oscillographe à
balayage circulaire. Et alors avec ça, les pianos étaient toujours
d’une justesse infinie.
Q. Dans quelles circonstances Sacha Distel vous a-t-il donné la
guitare ?
Sacha, je le connais depuis mille neuf cent cinquante et … Il est
venu faire un bœuf à Metz au Quatre-quatre, un club de jazz qu’on
avait créé. C’était un guitariste de jazz, Sacha. Il était toujours
en train de chercher une sonorité. A son époque, c’était le
meilleur. Il avait le style américain, le style Rainey. On s’est
connus comme ça.
Quand je suis venu à Paris, j’allais au Club St Germain, je faisais
le bœuf et tout ça. Il y avait Sacha et Jean-Pierre Cassel. Quand je suis arrivé à
Paris, je roulais en Porsche. Sacha et Jean-Pierre : « … un petit
inconnu qui vient à Paris en Porsche, qui joue de la guitare … » Il
[Jean-Pierre Cassel] avait déjà joué avec Becker et tout ça, et
Sacha, tonton Ray Ventura et Salvador, et tout ça … Il leur fallait
des Porsche. Ils ont acheté des Porsche. Ils en ont trouvé, rue Anatole-France, mais il n’y avait pas les pièces. Comme mon père
était en Allemagne et que j’allais le voir de temps en temps, quand
il y avait une pièce cassée, je la leur remmenais. Le soir, ils
allaient manger (j’étais « faucheman » ) le petit salé au Châtelet. Jean-Pierre Cassel,
j'allais chez son
père, le docteur Crochon, rue du faubourg Montmartre (c’était un
copain d’un médecin russe qui était à Metz). Je vois la photo de
Jean-Pierre Cassel sur son bureau. Je lui dit : « docteur, vous
connaissez Jean-Pierre Cassel ? » « Couillon, pardi, c’est mon fils
! Tu le connais ?» « Depuis 53 » « Jean-Pierre, viens voir … »
Il a
composé ça pour Brigeou. [Simon Lustigman joue le morceau]. Alors,
quand ils descendaient, bras dessus, bras dessous au Club
Saint-Germain en 53, on était jaloux : « Qu’est-ce qu’il a de mieux
que nous, lui, là … ». Qu’est-ce qu’elle était belle, Brigitte
Bardot ! C’était la guerre entre lui et Eddy Barclay, que j’ai connu
en 49. Il faisait le représentant de commerce avec deux disques. Il
vendait « Central Av. Breakdown » un boogie-woogie avec Lionel
Hampton au piano (avec deux doigts, il jouait) et l’autre ? C’est
Renée Lebas qui chantait ça...
[Sacha] on n’a pas été amis. J’allais chez lui, rue Blanche. J’ai
toujours gardé les distances avec lui, parce que lui, c’était une
vedette. Moi aussi, mais pas dans ce genre là. C’était Megève,
Brigitte Bardot… Mais quand il était quelque part, au Jazz Club
Lionel Hampton, là … il se levait, il venait. Il a toujours été bien
avec moi.


La chanteuse Nadine Gaudel : quel
talent! J’avais vu sa guitare et [j’assistais] à
une émission avec Sylvie Vartan, aux studios près des Buttes Chaumont, rue des Alouettes.
Elle était en vente chez les Jacobacci. Je la voulais cette guitare,
parce qu’elle avait le micro à barrette. Il en voulait un certain
prix. Je lui ai dit : « Sacha, toi tu es riche et tout … » Il m’a
dit « vas-y, prends la ! » J’ai été chez Jacobacci. [Roger,] il n’a
pas été chouette : il m’a dit « tu me dois 150 balles … ». Je lui ai
donné ses 150 balles et puis c’est tout.
C’est le modèle Gimenes. Tout était en or 24 carats. Il [Sacha
Distel] l’avait faite faire. Ils ont fait un cordier spécial pour
Sacha, gravé : « Sacha Distel ». Et les mécaniques aussi. C’étaient
des Grover américaines, dorées à 24 carats.
On faisait le repas des vieux [musiciens] à « La Bonne Franquette ».
Loulou Gasté, on a mangé ensemble juste avant qu’il ne meure. Il
venait au repas des vieux musiciens. Il y avait ses copains. Il y
avait Claude Normand, Roger Simon. Il avait un sacré coup de
fourchette. C’était organisé par Paul Fabre. C’était tous les ans.
Au début, c’était « A La Bonne Franquette », après ça a été à « La
Table d’Harmonie » au Quartier Latin. Paul Fabre. C’est un homme
merveilleux.
J’ai joué quelques années au Ritz.Il y avait aussi le bassiste des
Karting Brothers [S.L. à oublié son nom]. Ils venaient manger avec
Line [Renaud]. Je joue un air de Loulou. « Un par un vont les petits
indiens, deux par deux vont les amoureux, trois par trois vont les
petits soldats et moi … ». Elle s’est levée, elle est venue, elle
m’a dit [Simon Lustigman imite la voix de Line Renaud] « Vous
connaissez tout ça … ». Elle avait un popotin ! Je lui répond «
Line, on ne se voit pas, mais on s’entend si bien … » « Vous
connaissez ça !? ». C’est quand elle travaillait à Radio Luxembourg.
Il n’y avait pas la télé ; alors « on ne se voit pas » : bien sûr,
c'est la radio ! Alors du coup, Loulou est venu et il a joué avec
cette guitare là [la Gibson ES-175D] : « J’en ai une aussi … » Il
m’a dit : il faudra que tu viennes, qu’on compare nos Gibson.
La Gimenes de S. Distel, je l’ai revendue parce qu’elle sonnait pas.
Je l’ai gardée longtemps, parce qu’elle était à Sacha et tout ça et
puis il y avait ce micro à barrette qui donnait un certain son. Il a
un désavantage, ce micro : il ramasse tout ce qui passe. Le double humbucking est moins bien mais …J’ai changé le micro,
j’ai mis un P90 … Le manche était super. Le son : dans les basses,
c’était terrible, mais dans les aigus, elle sonnait … c’était entre
le percolateur et le Butagaz, vous voyez ? Roger, il faisait de très
bonnes guitares mais il ne se préoccupait pas du son. Il croyait :
bon, c’est une guitare, on met un micro de Steve, après un micro
Benedetti dessus et ça marche … Non ! Y’a le barrage qui intervient.
Ils ont toujours été gentils avec moi. Je l’aime beaucoup, il le
sait très bien. La vie, elle est ce qu’elle est. Je joue la musique
que je joue, et puis voilà !
Ma dernière aventure avec Sacha : vous connaissez Vintage Music, rue
de Douai ? Hertz, le tôlier … Je passe en voiture avec Jacqueline et
Sacha me voit. Il me fait « Simon, viens … » Il veut acheter une
Gibson, une autre, une demi-caisse en bois blanc [blonde]. Il me dit
: « Simon, joue-moi quelque chose et dis moi ce que tu pense de la
guitare. » Là, il n’a pas été malin : je suis chez Hertz. La
guitare, que je l’aime ou que je l’aime pas, je peux pas dire «
cette guitare là, je ne l'aime pas … ». Je ne vais pas me fâcher
avec Hertz ! Je lui dis « Moi, c’est pas mon style de guitare, mais
elle est bonne … »



La chanteuse Nadine Kieffer
On feuillette les catalogues Major ; on s’attarde notamment la «
liste impressionnante des Vedettes jouant sur RV ».

Marcel Bianchi, c’était la vedette, à l’époque. C’est un guitare «
Rio », ça. C’était en Suisse. Elle était très bien, elle marchait
bien. C’était une guitare américaine qu’ils vendaient en Suisse.
Rio, c’était le nom qu’il y avait sur la guitare. Elles étaient
blanches, le micro blanc.
Il jouait [aussi] de la guitare hawaïenne.
[Henri] Crola ! Il jouait au club St Germain. Alors quand j’arrive,
c’était en 53 : « Simon, prends la guitare, tu joue mieux que moi …
». C’était pas vrai, mais il voulait faire la pause. Je prenais sa
guitare, je jouais. Alors y’avait Jo Daly, il tirait la gueule,
[parce que ] je jouais moins bien. Henri, il draguait les nanas …
C’était terrible.
La première fois que j’ai été à Luxembourg, l’orchestre de la télé
s’appelait le « Chez Nous ? ». Le guitariste hollandais, Ted Van Dooeng,
lui aussi voulait faire la pause. Il me disait : « tiens, joue un
petit air… » Il m’a donné la guitare, j’étais pétrifié, j’ai pas osé
la toucher. On avait du respect, à cette époque. Magnifique guitariste…
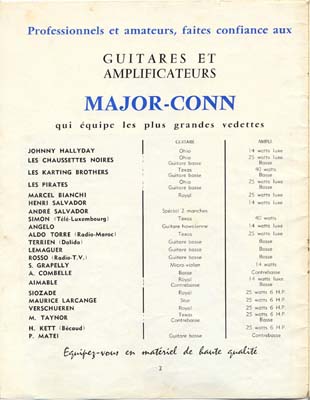


André Salvador [le frère d’Henri], il n’avait pas de voiture, il
venait toujours à vélo. Il était très talentueux, André, aussi. Il
faisait l’indien, chez Marc Taynor et ses Cow-boys. Il y avait aussi
Freddy Vander, le frère de Maurice Vander, qui a accompagné Nougaro
et tout ça.
Il jouait de l’accordéon. Ce n’est pas lui sur la photo : il jouait
d’un accordéon « boutons ». Marc Taynor, il a voulu m’avoir, mais
comme il payait pas terrible, je n’y allais pas. J’ai connu sa sœur
aussi, à Salvador.
Simon de Télé Luxembourg : Texas et ampli 40 w.…
Q. Mais c’est vous !
C’est moi ! Je ne savais pas qu’ils m’avaient mis dessus … [sur le
catalogue]
Q. A quel moment avez-vous joué avec Stéphane Grapelly ?
J’ai remplacé Tony Ovio. C’était son guitariste et son chanteur.
C’était un crooner, genre Sinatra.
Matelot Ferré. Baro Ferré, vous savez pourquoi on l’appelait Baro ?
Il était toujours en taule ! Il était derrière les barreaux, on l’a
appelé Baro. Matlo, il habitait avec Boulou qui était tout petit.
Boulou, j’ai vu qu’il avait du talent. J’ai dit [ à Matlo] « si tu
veux, je lui enseigne ce que je sais … » « Ah , non ! C’est nous
qu’on enseigne. » Boulou et son frère Elios.
Terrien. Il est mort aussi. Sa femme l’a fait crever avec les
séances … Elle prenait toutes les affaires!
[Raymond] Siozade, un accordéoniste, qui n’avait pas un poil sur le
caillou. Vous savez comment on l’appelait ? Le fœtus du dépliant !
On regarde le 25cm de Francine Adam et ses G'Men

C’est une D’Angelico [deuxième en partant de la gauche]. Mais ça, c’est des luthiers : il y a très peu
de gens qui peuvent s’en payer. Oh ! Lagodasse !! René Duchossoir
[3ème en partant de la gauche].
J’allais le remplacer. [dans l’orchestre de l’Olympia]. Lui aussi,
il a eu une déformation articulaire, il ne pouvait plus jouer. Et celui là
[4ème en partant de la gauche], il joue
sur une guitare avec les micros à Steve … C’étaient tous des bons
lecteurs, alors ils ont fait du studio. Moi non, je suis
autodidacte.
Q. C’est une Jaco ça …
Je ne suis pas sûr. Ça pourrait être une Favino.
J’ai une Gibson ES-100 avec l’étui d’origine de 36 ou de 38 [vers
1938 micro CC blanc rectangulaire], je vais vous la faire voir. Vous
pouvez la sortir, c’est le manche triangulaire. Des modèles Charlie Christian, y’en avait deux, chez Vintage
Guitars, rue de Douai. Moi, j’ai pris celle-là
[ES-100], parce qu’elle sonnait mieux. Boulou Ferré, il a pris
l’autre [ES-150]. Guidon me l’a retapée un peu.
François; Franz ! C’est une guitare qu’on ne peut plus jouer
aujourd’hui. Ça a un son doux et gentil. Aujourd’hui, il faut
rentrer dedans. C’est le modèle avant la Charlie Christian,
celle-là. C’est un micro à barrette. Il m’a changé les mécaniques
parce qu’elles étaient mortes. Je suis moins à l’aise que sur
celle-là [l’ES-175D]. C’est Dadi qui me l’a vendue. Il avait tous
les magasins [rue de Douai]. C’était un grand ami. On a joué ensemble chez mon copain milliardaire au Raincy deux jours avant qu’il ne prenne cet avion.
La Gibson ES-175 de S. Lustigman est équipée du chevalet
Lustigman/Brammer
Il y a un grain dans le son. Moi je le perçois. Cette guitare, elle
a un « grain » [démonstration]. Toutes les cordes, l’une comme
l’autre, elles sont de même niveau. J’ai mis 63 ans pour la trouver,
celle là … Les micros, moi, j’ai inversé [le micro chevalet], pour
que les plots soient en haut. Ils étaient en bas. Ça donne un son
aigrelet. Ce sont les super aigus qui sont là. C’est pas beau, alors
j’ai inversé le micro. Comme les luthiers ne sont pas guitaristes,
ils ne connaissent pas tout ça. Quand on fabrique des instruments,
il faut travailler avec des musiciens qui ont « de la feuille ».
Q. pourquoi avez-vous étouffé les cordes ? [sur la tête, avant le
sillet et entre le chevalet et le cordier].
Ça vient de mes accords de piano. J’avais remarqué que chez
Steinway, il y a deux chevalets. Il y a l’accord et il y a les
harmoniques. Quand les harmoniques coïncident avec la note que vous
jouez, ça donne une brillance particulière. Par contre, quand les
harmoniques ne coïncident pas, ça fait une vibration nocive. Je les
ai supprimées en mettant de la mousse. Ça me fait un son pur.
Q. Vous les jouez en les branchant sur un ampli ? Quel ampli ?
Sur le cube, l’américain. Le Polytone. Le Baby Brute. Un 100W. Il y
a un plus petit : un 85W. Ils sont moins biens.
Qu’est ce que vous voulez que je vous joue ? Je vous emmène au
cinéma … Butch Cassidy et le Kid, Raindrops keep falling on my head
[S. Lustigman utilise le pouce pour les basses]. Même sur celle là
[ES-100] il a fallu que François Guidon refasse le manche. Il était
jouable, mais pas pour ce que je viens de faire.
« Lady be good ». Ils savaient pas, les français. Alors, qu’est-ce
qu’on joue ? « Les bigoudis » !
Dans le temps, il n’y avait que Django. Et Django, c’est impossible
à jouer. C’était un génie. Il a même été en Amérique. Le concert de
Chicago, il les a tous mis sur les fesses, là. Il arrivé en retard
parce qu’il avait joué aux cartes (il adorait jouer aux cartes). Il
s’est fait plumer par la mafia. Il a joué ses godasses, il a perdu
ses godasses. Il a joué avec le smoking et des pantoufles. Les gens
commençaient à râler, parce qu’en Amérique, on est à l’heure. Et
puis il a fait trois notes et toute la salle : « Haaa … »
Moi, c’était pas mon truc. J’aime bien le style américain. Il y
avait Oscar Moore, le guitariste de Nat King Cole. John Collins. Il
a pété son ampli quand il a joué au Méridien, je lui ai prêté le
mien. On n’a pas pu apprendre des américains, sauf par les disques
en cire. Le premier que j’ai entendu vraiment, c’était Barney
Kessel. Il avait joué avec [Charlie] Parker. Et avec Red Rodney. Un
homme charmant. Il est venu jouer aussi au Méridien. J’ai travaillé
des années au Méridien, mais comme accordeur de pianos. Mais de
temps en temps j’allais jouer avec eux sur scène. Red Rodney, j’étais cul et chemise avec lui. Chaque fois il
m’envoyait une carte : « dieu te bénisse », c’était formidable.
Un autre guitariste, le plus grand de tous, c’est Tal Farlow. Là,
y’a rien à faire. Jim Hall et Jimmy Rainey. Quand j’ai entendu Tal
Farlow improviser, le sol s’est dérobé sous mes pieds. [S.L. joue My
Old Flame] Il a des pattasses comme ça, il fait des accords que
personne ne peut faire. Je l’ai vu deux fois. Je l’ai vu à Berlin.
Il y avait « Ploum, Ploum, Tra-La-La » . C’était comme Intervilles,
mais sur scène. Les gens étaient sur une planche savonnée et
tombaient dans un bassin. En deuxième partie « voici maintenant Mme
Edith Piaf ». J’allais me tirer. Moi, c’était Ella Fitzgerald, Sarah
Vaughan … Elle vient, petite, vilaine, une robe noire, la gueule
enfarinée, toute blanche … Y’avait Le Maguer à l’orchestre. 25
musiciens et l’orchestre. C’était à Metz. « Moi, je suis venu pour
l’orchestre, pas pour elle … ». Un vieux micro américain : « …Moi
j’essuie les verres au fond du café … ». Elle m’a mis une vis dans
les fesses ; j’ai pas pu partir jusqu’à la fin. Une personnalité !
Aujourd’hui, qui c’est qui a ça ?
Q. Les guitares, les amplis qui vous faisaient rêver …
Les Gibson ! Y’avait le son. Les Fender sont formidables, mais pour
la musique commerciale. Mais pour le jazz, il n’y a que Gibson.
Quand elles sont bonnes … Les
Gretsch, c’étaient de bonnes guitares. Il n’y avait pas de mauvaises
guitares, chez les américains. Moi j’avais les guitares Jacobacci.
Pour ce que je faisais, elles étaient bonnes. Je ne pouvais pas me
payer une Gibson.
Q. R. Gimenes, il a toujours acheté des Jaco…
Il était ami avec Michel [Benedetti], aussi.
On feuillette l’ouvrage Jacobacci.

Les Karting Brothers ! Roger David ! C’était un homme charmant. Il a
composé « La Blanche Colombe » pour Hugues Aufray. C’est lui le
premier en France, à part Marcel Bianchi, qui a adopté la façon de
jouer de Les Paul. Il avait des Revox, en deux pistes, il
enregistrait, en re-recording ça s’appelle. Un jour, il avait
rendez-vous rue Jenner, chez Philips. Il a pris sa bande et il a pris
le métro. Dans le métro, il y a des courants électriques : quand il
est arrivé, il n’y avait plus rien sur la bande. La guitare [la
double-manche blanche], il l’a
fait faire chez Jaco. Je ne sais pas s’il n’y en a eu qu’une. Il y a
les micros de Brammer, mon chevalet. La tête c’est la copie de la
Levin. Le vibrato Hagström, qu’ils ont copié. Vous l’avez sur les
enregistrements de Les Paul, Tiger Rag, notamment : ouam ouam … Le
Bigsby, ça s’appelle. [Les Paul] c’était un grand guitariste,
c’était un grand admirateur de Django. C’est lui qui a inventé les
magnétophones à 8 pistes, ça n’existait pas. La chambre d’écho,
comment il faisait ? Il jouait dans la cuisine. Avec le
haut-parleur, il envoyait le son dans la cave et quand le son
remontait, il le reprenait. Il y avait un « délai ».
Marcel Dadi, il était
représentant d’Ovation. Il ne pouvait pas jouer sur autre chose.
Marcel, je lui ai prêté ma guitare, il m’a dit « tu sais, les
Ovation, c’est bien, mais il n’y a rien au dessus de Gibson … ». Je
l’ai vu arriver à Paris tout petit, Marcel.
Jimmy Briant et Speedy West. Alors, là … La technique qu’ils ont !
[la pedal-steel] C’est un trois manches. Au point de vue musical,
c’est pas très intéressant, mais la technique … J’ai joué avec les
sudistes américains. Ils avaient des steel-guitars. Il y’en avait un
qui avait quatre manches. C’était de la folie furieuse. Il gagnait
plus que le capitaine de la base, à Metz.

Les Fingers. C’était le groupe concurrent des Stevens. Il y a
Jean-Marie Hauser à la batterie. Comment il
s’appelle ? Et puis celui que j’avais pris, il joue avec moi sur les
Stevens. [Yvon] Rioland ! Lui, il m’a quitté pour aller là. Les RV25 , ils étaient ouverts derrière, pour les lampes. On
avait trouvé qu’un groupe de 6L6 ce n’était pas assez puissant. La
lampe, à haute puissance, elle décline, elle distord. Il y a deux
push-pull de deux
6L6.
Apicella. Lui aussi … Il a choppé un cancer de la gorge. Il est
parti vite. Il jouait [avec les Guitars Unlimited ] la guitare basse
[à six cordes].
Pierrot [Pierre Cullaz], c’est lui qui m’a donné mon premier micro
Gibson, le P90, le noir. Le son est joli … mais il ramasse aussi !
Le 15 janvier 2008. Questions posées par Marie-Claire Lory, Marc
Touché et Marc Sabatier
Merci à Jean Debèze
Merci à Jacqueline pour le thé
|
|

